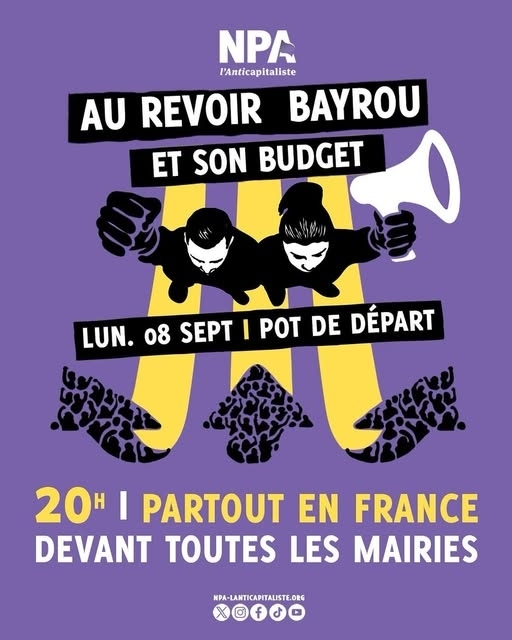samedi 13 septembre 2025
place Garibaldi
à partir de 17 h 00
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi 13 septembre 2025
place Garibaldi
à partir de 17 h 00
Donald Trump multiplie les purges à la tête d’institutions fédérales et déploie la Garde nationale dans plusieurs villes. Ces mesures autoritaires suscitent des condamnations massives et une mobilisation populaire.
Trump a mis l’été à profit pour continuer à démanteler la démocratie et avancer vers un État autoritaire et réactionnaire. Trump a limogé trois hauts fonctionnaires. Il a d’abord licencié Erika McEntarfer, commissaire du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail), Lisa D. Cook, gouverneure de la Federal Reserve Bank (banque centrale américaine), et Susan Monarez, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Aucun autre président n’avait jamais procédé à de tels licenciements à la tête d’institutions quasi sacro-saintes, qui régulent l’économie et protègent la santé publique.
Trump a également affirmé son pouvoir dans les rues des villes américaines. Lorsque les habitantEs de Los Angeles ont protesté contre les rafles et les arrestations menées dans le cadre de sa politique d’immigration, ce qui a conduit à des affrontements avec la police de Los Angeles, Trump a directement mobilisé la Garde nationale en juin, envoyant 2 000 gardes à Los Angeles ainsi que 700 marines et de nombreux agents de l’ICE (Service de l’immigration et des douanes). La maire de Los Angeles, Karen Bass, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ont tous deux qualifié l’occupation militaire d’une partie de la ville d’inutile et d’autoritaire. Le gouverneur a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral et obtenu une ordonnance restrictive temporaire.
À la mi-août, Trump a déclaré « l’état d’urgence criminelle » dans la capitale nationale et a pris le contrôle de la Garde nationale de Washington, DC, ainsi que du département de police de la ville. Le 8 août, Trump a envoyé des centaines de fonctionnaires fédéraux d’autres agences, telles que le Federal Bureau of Investigation (FBI), patrouiller dans les rues de Washington. Bien que la ville compte effectivement des quartiers à forte criminalité, le taux d’homicides et d’autres crimes violents est en réalité en baisse. Washington, DC étant un district fédéral et non un État, le président est constitutionnellement habilité à en prendre le contrôle. Mais il a également promis d’envoyer des agences fédérales et des troupes dans d’autres villes : Chicago, New York, Baltimore et Oakland, toutes gouvernées par des démocrates.
Dans l’Illinois, le gouverneur J.B. Pritzker et le maire de Chicago, Brandon Johnson, ont tous deux condamné le projet de Trump d’envoyer des troupes, le qualifiant d’inutile et de menace pour la démocratie américaine. Quelque dix-neuf gouverneurs démocrates ont également affirmé qu’ils ne voulaient pas de troupes ni de policiers fédéraux dans leurs États. Les troupes et les agents de Trump ne contribuent guère au maintien de l’ordre, ils jettent les bases d’un potentiel coup d’État militaire.
La manifestation pacifique No Kings Day, qui s’est déroulée à travers les États-Unis le 14 juin 2025, a été la plus grande manifestation d’une journée de l’histoire du pays. En août, les manifestations ont diminué.
Le Democratic Socialists of America (DSA), la plus grande organisation socialiste du pays avec 80 000 membres, a tenu son congrès à Chicago le mois dernier. Les nombreux courants politiques de l’organisation — gauche, droite et centre — se sont disputés sur les procédures et ont adopté une résolution de soutien à la Palestine, mais il y a eu peu, voire pas, de débats sur la politique américaine et sur la manière d’arrêter Trump.
Mais l’automne approche et des mobilisations plus massives sont attendues lorsque les étudiantEs retourneront sur leurs campus et que les gens reprendront le travail. Il faudra être dans la rue par millions.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
L’exclusion des principaux candidats de l’opposition de l’élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre jette une ombre sur le scrutin et alimente le risque de violences politiques dans un pays marqué par une longue histoire de crises électorales.
Depuis une trentaine d’années, les élections présidentielles en Côte d’Ivoire sont à l’origine de graves tensions politiques ayant débouché sur des violences, comme lors du scrutin de 2020 où plus de 85 personnes ont été tuées, sans compter les centaines de blessés. Les élections du 25 octobre prochain ne semblent pas, hélas, échapper à la règle.
L’élément majeur de la crise est l’exclusion de la liste électorale, pour des motifs divers, de candidats comme Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse, Guillaume Soro, ex-Premier ministre, et surtout les deux principaux opposants : l’homme d’affaires Tidjane Thiam du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI) et l’ancien président Laurent Gbagbo, dirigeant du Parti des peuples africains (PPA-CI). Ces interdictions de se présenter retirent toute crédibilité au scrutin et pourraient générer des tensions politiques, aggravées par les dimensions communautaires liées à l’implantation de ces dirigeants dans leurs fiefs régionaux. Cette fragilité du processus électoral s’explique aussi par d’autres griefs : le quatrième mandat du président actuel, Alassane Ouattara, rendu possible par le changement constitutionnel du 30 octobre 2016 qu’il a initié pour contourner l’interdiction de plus de deux mandats successifs ; une liste électorale de huit millions de personnes sur un total de plus de douze millions de votants potentiels ; une Commission électorale indépendante décriée ; une justice considérée comme aux ordres du pouvoir.
Les premières protestations ont eu lieu le 9 août à Abidjan, la capitale, où des milliers de manifestantEs, essentiellement du PDCI et du PPA-CI, sont descendus dans la rue. Ce succès va probablement encourager les opposantEs à maintenir la pression. D’autant qu’une organisation comme le PDCI, fondé par Houphouët-Boigny, qui a dirigé la Côte d’Ivoire pendant plus de trois décennies, bénéficie d’un fort enracinement à travers le pays. En face, le pouvoir, comme à son habitude, va passer outre et ne prendra pas le risque d’une ouverture politique débouchant sur un cadre électoral inclusif. Fort de son succès économique, certes réel mais très inégalitaire, avec une inflation, un chômage et une faiblesse des infrastructures de santé persistants, Alassane Ouattara opte pour le passage en force. Pour ces élections, les moyens de l’État seront mobilisés pour sa campagne. Déjà, une vague répressive s’abat sur les opposantEs, notamment ceux du PPA-CI, particulièrement visés. Ainsi, des cadres de ce parti comme l’ancien ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi ou l’ex-ambassadeur Boubacar Koné sont en garde à vue. En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique, les élections n’ont qu’une seule finalité : la conservation d’un pouvoir autoritaire sous un vernis démocratique.
Paul Martial
Depuis plus d’un demi-siècle, le Sahara occidental reste le théâtre d’une colonisation niée et d’une lutte de libération occultée.
Après cent ans de domination espagnole, l’occupation marocaine s’est installée en 1975 à la faveur de la « marche verte », présentée par Rabat comme une mobilisation pacifique mais vécue par les SahraouiEs comme une invasion militaire. Bombardements au napalm et au phosphore, déplacements forcés et répression ont marqué le début d’une occupation soutenue par les puissances impérialistes et par Israël, fournisseur d’armes et partenaire du Maroc.
Qualifier le Sahara occidental de « conflit gelé » alors que la guerre de libération a repris depuis près de quatre ans et que les Nations unies appellent à la tenue d’un référendum chaque année depuis près de 35 ans est une falsification. Le cessez-le-feu de 1991 n’a jamais débouché sur le référendum d’autodétermination promis. Le recensement des votantEs est prêt depuis 2002, mais Rabat bloque le processus en installant des colons, les faisant passer pour des autochtones, comme la France le fait en Kanaky. En novembre 2020, le Maroc a rompu la trêve à Guerguerat : depuis, la guerre a repris. Cette occupation s’appuie aussi sur une infrastructure militaire titanesque : un mur de sable construit dans les années 1980, long de plusieurs milliers de kilomètres, protégé par des millions de mines antipersonnel. C’est la plus vaste zone minée au monde, symbole d’un apartheid colonial.
Au-delà du militaire, le Maroc déploie une stratégie économique et idéologique. Phosphates, pêche, énergies renouvelables : les ressources du Sahara sont exploitées par des entreprises marocaines et occidentales, malgré des décisions juridiques qui déclarent ces accords illégaux. Le soft power se traduit par le tourisme, les investissements et des infrastructures qui ne profitent pas aux SahraouiEs. Dans les territoires occupés, il n’existe presque pas d’universités. Ces projets servent d’abord à blanchir l’occupation et à attirer des colons avec des avantages fiscaux et fonciers.
La majorité des SahraouiEs vivent toujours dans les camps de réfugiéEs de Tindouf, en Algérie. Ces exiléEs portent la mémoire d’un peuple dispersé, privé de ses terres et de ses droits. Les prisonniers politiques sahraouis et les révoltes écrasées, comme celle de Gdeim Izik en 2010, véritable déclencheur du « printemps arabe », rappellent la brutalité d’un régime qui nie jusqu’à l’existence d’un peuple. Réduire cette lutte à une rivalité entre Maroc et Algérie, comme le répète la propagande, revient à invisibiliser le sujet central : un peuple colonisé. Le Sahara occidental n’est pas un dommage collatéral de tensions régionales, mais une lutte de libération nationale.
Le parallèle avec la Palestine est évident : murs, déplacements forcés, exploitation des ressources, criminalisation de la résistance. Dans les deux cas, l’occupation est soutenue par des États impérialistes et des investisseurs. Dans les deux cas, les coloniséEs se battent pour l’autodétermination et la justice. Le Sahara occidental est reconnu par l’ONU depuis 1963 comme territoire non décolonisé. Mais les résolutions ne suffisent pas : sans rapport de forces, le droit reste lettre morte. La libération dépend de la solidarité internationale, de la dénonciation des mensonges historiques et de l’affirmation d’un internationalisme conséquent. Pour les SahraouiEs, l’enjeu est clair : il ne s’agit pas de négocier un compromis territorial, mais de reconquérir l’ensemble de leur pays et de permettre le retour des exiléEs. C’est une question de dignité et de justice. Leur horizon est celui d’un Sahara libre, du nord au sud, comme les PalestinienNEs rêvent d’une Palestine libre, du fleuve à la mer.
Fatimetu et Amel
Dans le 06, le 10 septembre...
==> À partir de 8h sur le rond-point de la Provence à Antibes (rond-point de Carrefour).
==> À partir de 10h, devant le siège du MEDEF du 06, 273 Avenue Georges Guynemer - Cap Var C2, 06700 Saint-Laurent-du-Var avec conférence de Presse à 11h.
==> À 14h rassemblement avec les étudiant·es de Carlone devant la gare de routière de Nice Magnan (devant la caserne de pompiers).
Ça y est, c’est la rentrée ! C’est l’occasion de revenir sur ce qui a marqué notre fin d’été : l’université d’été du NPA à Port-Leucate. Quatre jours de débats, de formations et d’échanges pour préparer une rentrée déjà agitée : mobilisation du 10 septembre, appel à la grève, vote de confiance, municipales… Pour avancer sur nos revendications, il va falloir nous préparer et rester prêtEs à nous battre
Ce sont plus de 750 personnes qui ont participé à notre université d’été, profitant de ce dernier moment avant la reprise pour échanger sur la rentrée et nos moyens d’action, avec pour perspective la mobilisation de toute notre classe pour renverser ce gouvernement.
Fidèles à nous-mêmes, nous avons mené cette discussion avec différentes organisations du mouvement ouvrier : partis, syndicats et associations. Lors du forum central, nous avons réuni autour d’une même table LFI (La France insoumise), UCL (Union communiste libertaire), ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne), PCF (Parti communiste français), CGT (Confédération générale du travail), Solidaires, FSU (Fédération syndicale unitaire), Nouvelle Donne… afin de discuter ensemble des perspectives et du travail à venir. Il y a urgence : nous devons faire face aux attaques du gouvernement et à la montée de l’extrême droite. Il s’agit de nous organiser collectivement pour frapper fort.
Bien sûr, l’université d’été est aussi un moment de formation sur des sujets variés : retour sur nos conditions de travail, alimentation, sécurité sociale, luttes antiracistes… Nous avons également abordé les questions internationales : guerre en Ukraine, génocide en Palestine, répression du peuple kanak, mais aussi montée du colonialisme, des guerres et du militarisme.
Quel plaisir de voir tant de camarades réuniEs, faisant vivre le NPA et nos luttes dans un moment festif et familial ! Cette année, il y en avait pour les grandEs comme pour les petitEs : un premier programme pour les enfants, des événements artistiques — drag show, conférence gesticulée, projections de films… Entre alimentation végétarienne, assemblée générale des participantEs, tâches partagées, nous avons expérimenté de nouvelles pratiques pour imaginer la prochaine édition. Alors, disons-le tout de suite : à l’année prochaine !
Commission université d’été
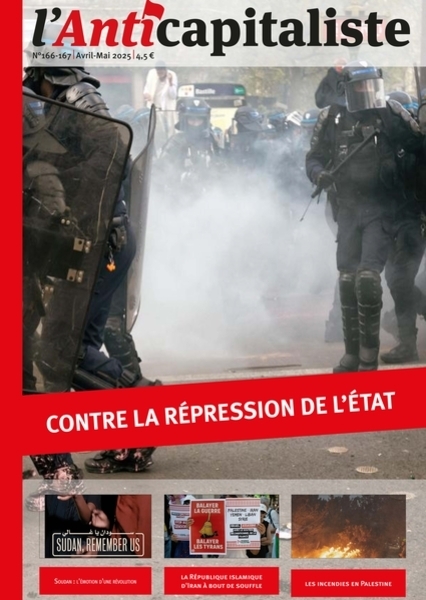
Un clic ICI...
L’Ukraine résiste envers et contre tout. Tandis que Trump déroule le tapis rouge à Poutine, syndicats, féministes et militantEs LGBTQI+ poursuivent leur lutte sur tous les fronts. L’UE n’apporte qu’un soutien superficiel à l’Ukraine et prépare la fin de la protection temporaire. La solidarité internationaliste est un impératif : elle ne doit pas être à géographie variable, ni subordonnée à des calculs géopolitiques. Par le Groupe d’intervention Solidarité Ukraine du NPA et Dominique Boury.
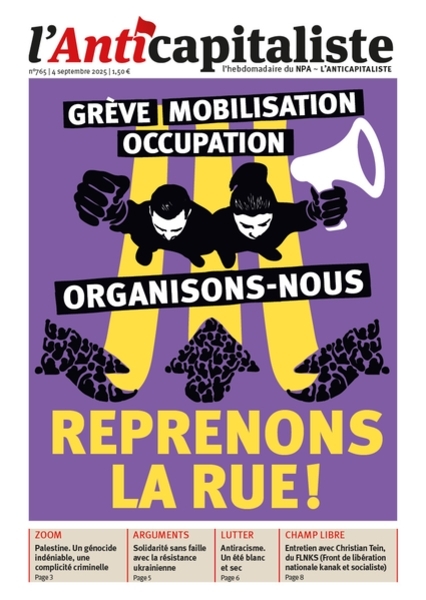
Un clic ICI...