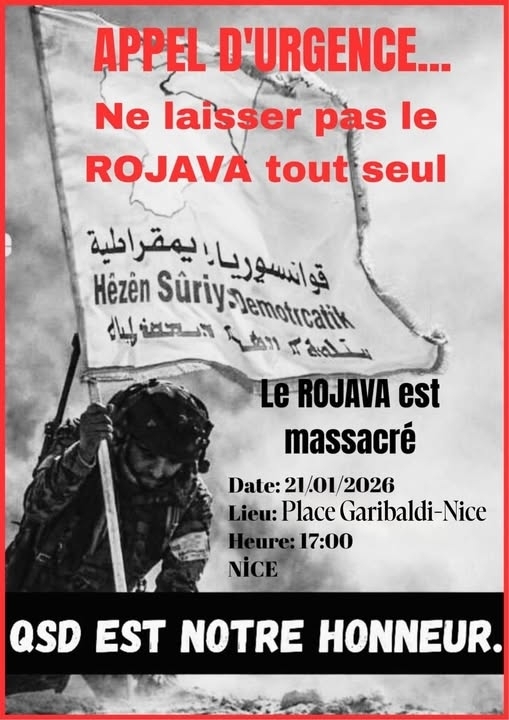Avec Trump 2, encore plus virulent et raciste, l’ICE (la police fédérale de l’immigration) multiplie arrestations et rafles. En 2025, près de 400 000 personnes ont été expulsées des Etats-Unis et plusieurs dizaines sont mortes. Le 7 janvier à Minneapolis, Renee Nicole Good est assassinée par un agent de l’ICE qui lui tire dessus à bout portant alors qu'elle tente de s’éloigner.
Violences d’État contre les migrantEs aux USA…
Trump a fait de son programme anti-migrantEs une priorité : 14 millions de personnes sont ciblées. Une fois arrêtées, aucun moyen de défendre leurs droits : sans pouvoir contacter leurs proches ou un avocat, elles sont détenues dans des conditions dégradantes, renvoyées vers des pays qu’elles ne connaissent pas, elles disparaissent purement et simplement.
En réponse, toute une partie de la société s’organise : en prévenant dès que l’ICE arrive, en cachant des cibles, en filmant, en soutenant la défense juridique. Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations « ICE out for good !» (« ICE, dehors pour de bon! ») les 10 et 11 janvier.
… mais en Europe et en France les violences policières tuent aussi
Depuis 2014, plus de 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée ou dans la Manche, parce que les voies de migration sont fermées et le sauvetage criminalisé. Frontex – l’ICE de l’UE – refoule et tue. Il faut y ajouter les milliers de décès aux frontières terrestres, dans les Balkans ou le Sahara. L’externalisation des frontières délègue la violence à des régimes autoritaires.
Les images du meurtre de Renée Nicole Good sont glaçantes. Elles nous rappellent celui de Nahel, 17 ans, tuée à bout portant par la police en juin 2023. Et ça continue ! Dans la nuit du 13 au 14 janvier, El Hacen Diarra est décédé au commissariat de Paris 20e, après avoir été violemment interpellé devant le foyer où il était hébergé. Sur une vidéo, l’on entend distinctement crier « Vous m'étranglez ! ».
À bas l'ordre policier et raciste !
Il s’agit d’une politique globale, dont l’objectif est le même, ici et là-bas : maintenir un ordre policier et raciste, au service de la propriété capitaliste.
Il faut agir pour l’abrogation des lois sécuritaires, la fin des contrôles au faciès, le désarmement de la police, la dissolution de tous les corps spéciaux de répression, la fin de l’impunité policière, l’abrogation des lois racistes et islamophobes.